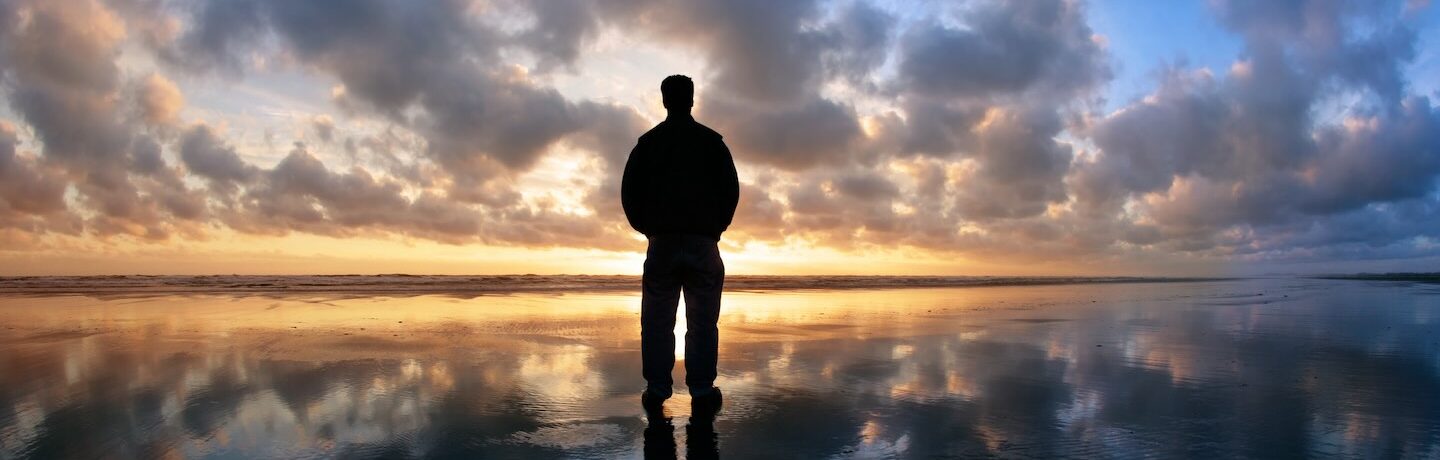Comment anticiper l’avenir énergétique, climatique et social de la France ? Après Transition(s) 2050, l’ADEME relance son grand exercice de prospective pour mettre à jour ses scénarios de neutralité carbone. Publication prévue fin 2026 ! Nouveaux enjeux, nouveaux outils, nouveaux partenaires : cet exercice veut offrir une vision plus réaliste et plus complète, utile aux décideurs comme aux citoyens.
Pourquoi c’est important ?
La prospective, à la différence de la prévision qui prolonge simplement les tendances, explore les futurs possibles en intégrant l’hypothèse de ruptures sociales, économiques, technologiques ou environnementales. Pour l’ADEME, c’est un outil stratégique majeur : depuis 2011, l’agence construit différents scénarios pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, en modélisant les évolutions possibles de l’ensemble des secteurs (énergie, alimentation, mobilité, industrie, ressources, puits de carbone). Cette démarche éclaire les choix politiques et économiques à court et moyen terme, tout en nourrissant le débat public et les lois de programmation sectorielles.
Un exercice pour actualiser et élargir Transition(s) 2050
En 2021, l’ADEME avait publié Transition(s) 2050, soit quatre grands scénarios pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Mais en quelques années, le contexte a profondément changé : pandémie, guerre en Ukraine, crise énergétique. « Les scénarios précédents utilisaient des données de 2015 pour le calibrage des modèles. Aujourd’hui, il faut les actualiser et surtout intégrer de nouveaux enjeux », explique Mathilde Convert, coordinatrice prospective à l’ADEME. La nouvelle prospective met en lumière l’écart entre le chemin pris ces 4 dernières années (le « scénario tendanciel » qui sert de référence et qui a été mis à jour) et les quatre trajectoires conçues en 2021. Elle élargit aussi le champ d’analyse : biodiversité, eau, impacts sociaux, économie circulaire, intelligence artificielle et adaptation au climat sont désormais intégrés.
Une nouveauté : six territoires passés à la loupe
Dans ce nouvel exercice de prospective , les territoires occupent une place centrale. L’ADEME prévoit d’illustrer ses scénarios sur six territoires pilotes. L’objectif est de descendre à l’échelle locale afin de traduire concrètement les scénarios nationaux de neutralité carbone et de montrer leurs effets sur l’énergie, l’économie, l’aménagement, la mobilité ou encore les modes de vie. Cette approche territoriale permet de rendre visibles les choix possibles, d’identifier les spécificités locales (métropoles, villes moyennes, zones rurales) et d’alimenter le débat public en rapprochant la prospective des réalités vécues par les acteurs locaux et les citoyens.
Le scénario tendanciel, un futur « par défaut »
Le scénario tendanciel est une trajectoire qui prolonge les dynamiques actuelles sans changement majeur de cap politique ou technologique. C’est le scénario qui sert de référence. Il permet de mesurer l’écart entre ce que donnerait une continuité de l’existant et les scénarios « volontaristes » qui visent explicitement la neutralité carbone en 2050. Ce scénario tendanciel est particulièrement important car il sert de point de comparaison global. Ce nouvel exercice mettra en avant ce qui se passera si la France continue sur sa trajectoire actuelle à différents niveaux : impacts sur les émissions, sur l’eau, la biodiversité, l’économie, etc.
Une approche multicritères et partenariale unique en France
Le projet a démarré fin 2024 et mobilise l’ensemble de l’ADEME, avec un pilotage croisé entre la Direction exécutive Prospective et Recherche (DEPR) et la Direction de l’Expertise et des Programmes (DEEP). Il associe également des partenaires externes : RTE pour l’électricité, INRIA pour le numérique, le CEREMA et Le Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan pour l’eau, la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) et l’Office National pour la Biodiversité (OFB), ainsi que NaTran pour le gaz. Chaque secteur (transport, agriculture, industrie, bâtiments…) modélise ses propres trajectoires à l’aide de modèles spécifiques. Le processus est organisé en quatre itérations (« runs ») successives, permettant de vérifier la cohérence des résultats et d’ajuster les scénarios. « L’idée est d’avoir des discussions entre ces itérations pour identifier les incohérences et déséquilibres emplois/ressources. Ainsi, à chaque fin de run, on a des bilans énergétiques et GES et une vision globale des déséquilibres entre les consommations et productions d’énergie, le but étant de résorber ces déséquilibres au run suivant » indique Victor Le Fourn, chef de projet numérique à l’ADEME.
Zoom sur trois outils essentiels
L’ensemble des modèles systémiques utilisés constituent les briques essentielles du dispositif. Trois outils jouent notamment un rôle central :
- Prospera : un entrepôt de données développé par l’ADEME pour centraliser toutes les modélisations sectorielles et calculer les bilans énergie et gaz à effet de serre. Cet outil était externalisé dans le précédent exercice, il fait désormais partie des outils ADEME dédié aux travaux de prospective et en constitue son coeur.
- MatMat : un modèle en aval qui évalue les empreintes matières et carbone associés à chacun des scénarios.
- ThreeMe : un modèle macroéconomique qui teste la robustesse des scénarios en simulant leurs impacts sur l’économie.
« Prospera est utilisé tout au long du projet. MatMat et ThreeMe, eux, interviennent après certains runs, pour vérifier si nos scénarios tiennent la route en termes de ressources et d’équilibres macroéconomiques » précise Victor Le Fourn.
Des résultats à partager… et à débattre
Les résultats seront publiés fin 2026. L’ADEME prévoit aussi un webinaire dès l’automne 2025, pour associer les parties prenantes : entreprises , collectivités, ONG et décideurs publics. Une large mise à disposition des données en open data est toutefois prévue afin de permettre leur réutilisation.